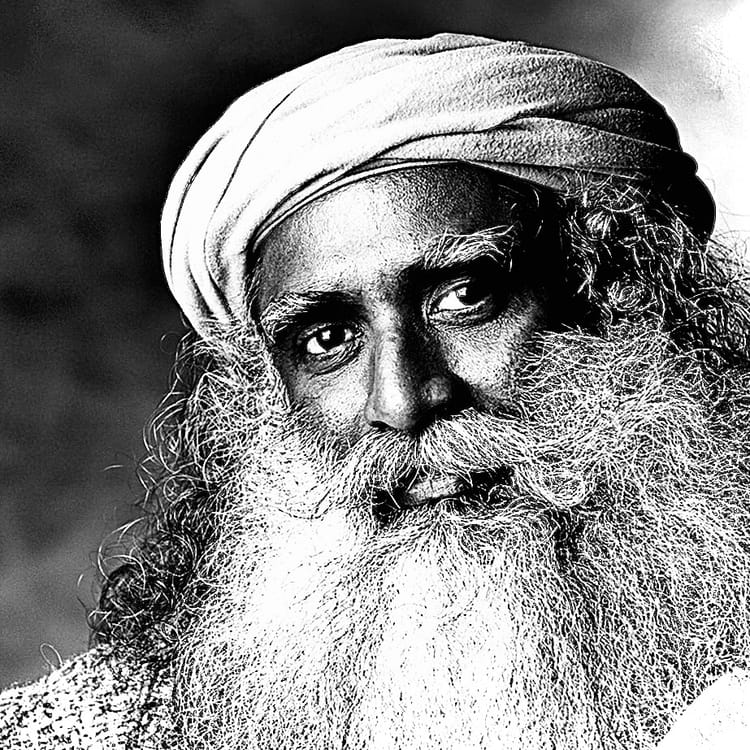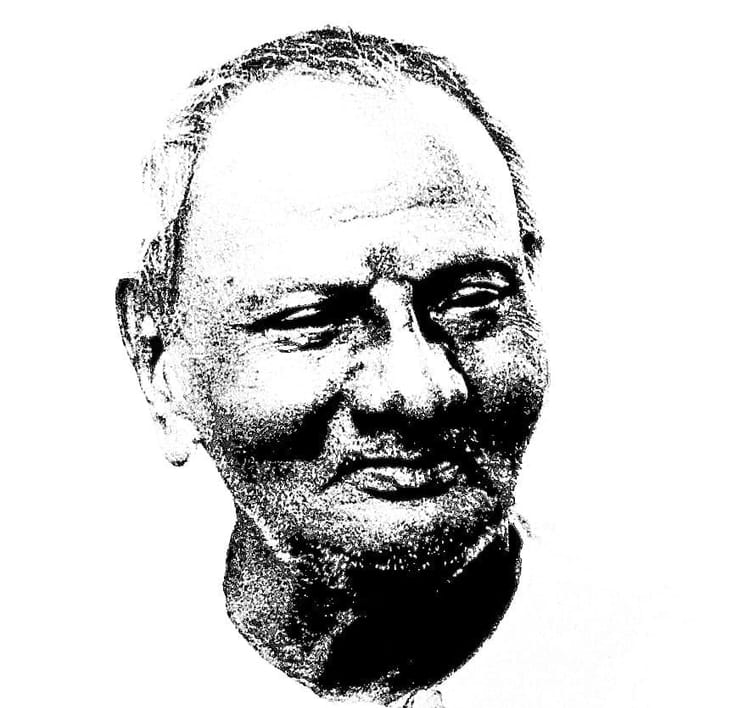L’échec de la Raison
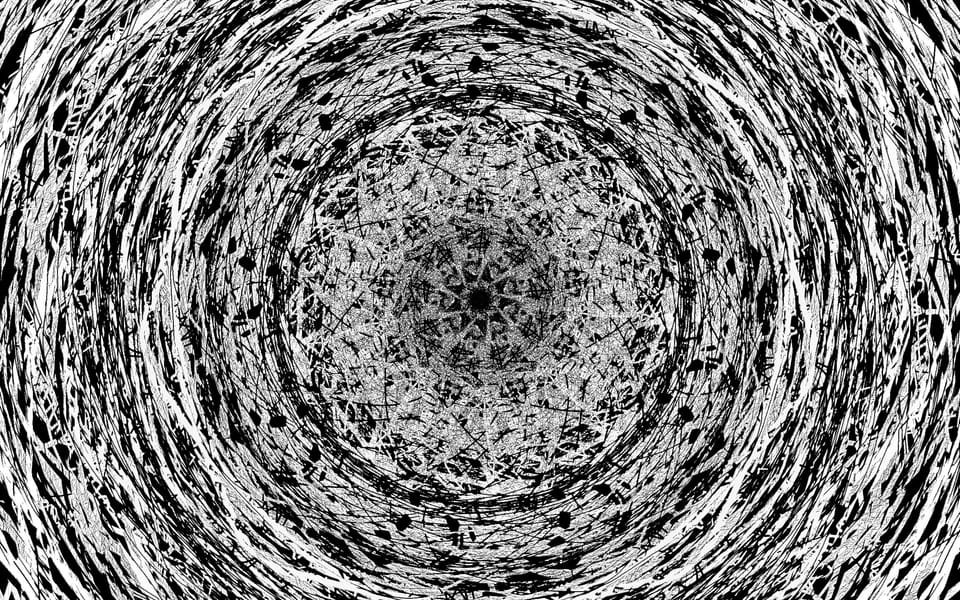
« La raison nous impose des limites bien trop étroites et nous invite à ne vivre que le connu — encore avec bien des restrictions — et dans un cadre connu, comme si nous connaissions la véritable étendue de la vie. »
— C. G. Jung
Les idées sont les fantômes de nos intuitions, toujours plus vaporeuses, distantes, dogmatiques et mensongères.
Celles qui se trahissent le moins ont donc naturellement tendance à se dérober à leurs contours, ou à en choisir de nouveaux dès que ceux-ci leur deviennent trop impropres ; préférant demeurer dans leur intuitive et innocente incomplète complétude primordiale plutôt que de muter en une forme dans laquelle elles ne se reconnaissent plus.
À l’inverse, celles qui veulent à tout prix prendre corps finissent bien souvent par n’être plus que l’ombre d’elles-mêmes — de simples intuitions avortées.
Les idées ne sont que des traductions passagères, des habits que l’on se doit de laver et de changer pour maintenir une certaine hygiène.
Car la nausée de l’esprit survient justement lorsqu’on s’y accroche éperdument, se retrouvant pris avec elles dans la machine à laver et ne faisant alors plus que boucler sur soi-même, jusqu’à en convulser de vertige.
« Le Tao que l’on peut nommer n’est pas le Tao éternel. »
— Lao-tseu
L’erreur que nous commettons bien souvent est de finir par confondre l’idée avec le phénomène qu’elle pointe, la carte avec le territoire qu’elle se vante de représenter.
En cela, le Tao — un concept définissant l’absolu — est une idée particulièrement forte, car elle se dédouane instantanément d’elle-même.
Elle nous rappelle qu’elle échoue à nommer ce qu’elle cherche à nommer, précisément puisqu’elle le nomme. Et c’est donc de ce paradoxe qu’elle tire toute sa pertinence ; invoquant l’existence du territoire dont elle tente de parler, mais nous laissant, dans le même temps, parfaitement incapables de le saisir au moyen de l’intellect.
Le Tao nous dit : voici la carte, mais elle ne vous servira à rien tant que vous n’irez pas visiter le territoire par vous-mêmes.
Car, naturellement, la seule chose que peuvent réellement dire des idées qui tentent de faire parler ce qui se trouve au-delà d’elles-mêmes, c’est précisément le fait qu’elle ne peuvent rien en dire.
Elles ne font que parler d’une réalité bien trop première, intérieure et universelle pour qu’elle puisse être retransmise dans des termes qui, justement, surviennent après elle.
Autrement dit, lorsqu’il s’agit de comprendre la réalité en tant que telle, nous devons nécessairement inverser notre perception et accepter de ne pouvoir en parler. Car c’est comme si nous essayons de rendre compte du contenant en nous servant des choses qui y sont contenues — cela est impossible.
Nous pouvons seulement tenter d’en évoquer la factualité, et, peut-être, en dire un peu à propos de ce lieu intérieur où il est possible d’en faire l’expérience.
« Je prie Dieu de me libérer de Dieu. »
— Maître Eckhart
Et voici ce qu’il se produit lorsqu’une idée finit par rencontrer, puis se rendre à l’évidence de son insuffisance.
Ici, ce n’est pas une prière qui demande ; c’en est une qui désire s’abandonner totalement.
Ce que Maître Eckhart implore ici n’est en effet pas d’être délivré de Dieu en tant que Réalité, mais de l’idée de Dieu : celui que l’on s’imagine, que l’on pense, que l’on croit encore être une chose particulière. Car ce dernier est celui du mental : une projection, une image que nous avons nous-mêmes façonnée.
Alors que le premier, celui qui libère du second, n’a plus de nom, plus de forme, ni même de réalité séparée de la nôtre. Il n’est pas une idée, mais une expérience directe et subjective ; il est ce qui demeure lorsqu’il n’y a plus ni prière, ni priant, ni prié.
Que le Nom me dépouille de la nécessité de le nommer — voilà ce que cette phrase signifie réellement.
Que le regard cesse de chercher l’Innommable ailleurs qu’en lui-même, car tant qu’il y a un « Dieu » que je peux concevoir, il y a encore deux ; il y a encore ceci et cela, et donc, Dieu, en tant que réalité, ne peut advenir.
C’est là l’exigence de la mort du concept de Dieu : celle de l’effondrement du pont dressé vers l’« au-delà », pour que seul l’océan, qui s’est toujours étendu en dessous, puisse sereinement demeurer.
C’est le même silence que convoque le Tao, le même qui cherche à s’affranchir de la nécessité de penser, le même que celui du Christ lorsqu’il eut à dire : « Mon Père et moi ne faisons qu’un. »
Une prière sans prière, une foi sans objet, une béatitude conséquente d’elle-même, un Dieu… sans Dieu.